Chapitre 9: Quand le brouillard se dissipe…
J’ouvris les yeux à 5h30 du matin. J’eus tout de suite l’impression qu’un voile de brouillard s’était dissipé dans ma tête. J’avais soudainement les idées claires. Comme mes seins étaient engorgés, je pris le temps d’extraire mon lait. Et c’est à ce moment que la pénible réalité me frappa de plein fouet. Je fus alors pleinement consciente de mon état, du trouble mental qui m’affectait. Je savais que durant les dernières semaines, je n’avais pas été moi-même. Je comprenais clairement la raison de mon hospitalisation et la nécessité de me traiter avec des médicaments. Je n’étais pas en mesure de m’occuper d’Elliot seule en raison d’une maladie mentale, d’un trouble de l’humeur relié au post-partum. Un flot immense de tristesse m’envahit alors. Ce que j’avais toujours craint depuis bien des années se réalisait : la maladie mentale m’affectait au point de perdre contact avec la réalité… Je n’arrive pas à expliquer pourquoi, mais j’avais depuis longtemps une certaine peur qu’une maladie mentale m’affecte un jour. Ce que je redoutais le plus, c’était la schizophrénie, sachant que ceux qui en sont atteints perdent effectivement contact avec la réalité. Bien que je savais que je n’étais pas atteinte de cette maladie, le seul fait de reconnaître que je n’avais pas le contrôle sur mon état mental m’affligeait énormément. Je perdais l’autonomie nécessaire pour m’occuper adéquatement de mon enfant. Je devais maintenant dépendre de mon entourage et d’un médicament pour bien tenir mon rôle de mère… C’était définitivement pénible à accepter. La seule chose que je sus faire en ce moment de révélation fut de pleurer. Un deuil s’amorçait…
Entre mes larmes, je terminai d’extraire mon lait puis j’appelai une infirmière pour qu’elle puisse le déposer dans le réfrigérateur. Celle qui répondit à mon appel me trouva dans un pitoyable état. Entre mes sanglots, je tentai de lui faire comprendre ma détresse en lui expliquant que j’étais maintenant consciente du trouble du post-partum qui m’affectait. Elle devait probablement en avoir été avisée car elle tenta de me consoler en me disant que je guérirais et que je finirais par me sentir mieux. Ne voulant probablement pas me laisser seule à pleurer et voulant me changer les idées, elle m’invita à la suivre jusqu’au poste des infirmières. Elle m’offrit alors une chaise à côté de deux autres infirmières dont l’une travaillait à son ordinateur tout en échangeant des conversations à propos de tout et de rien. En me voyant sangloter, cette dernière m’encouragea à cesser de pleurer en me disant que ça ne me faisait pas de bien. Mais j’en étais incapable et ce conseil ne fit que me faire sentir incomprise. J’avais besoin d’exprimer ma peine et surtout qu’on prenne le temps de m’écouter. Bien que les infirmières tentèrent à quelques reprises de m’inclure à leurs discussions, je ne me sentais pas à ma place. Je décidai donc, après peu de temps, de retourner à ma chambre. Comme j’avais cessé de pleurer, les infirmières ne s’y objectèrent pas.
Une fois arrivée à ma chambre, je m’assis sur mon lit et je saisis quelques feuilles de papier. Au lieu d’appeler mon mari et ma mère et les réveiller de si bonne heure, je me mis à faire ce que je savais être le plus utile pour le moment : mettre en mots mon pénible désarroi.
Voici donc le contenu de ce que j’ai rédigé.
3 octobre, 6h14 a.m.
Médication prise pour la première fois hier soir à 9h15 p.m.
Je me suis réveillée pour extraire mon lait. Maintenant, je réalise… Je suis beaucoup plus consciente de ce qui m’arrive et de ce qui m’est arrivé… C’est tellement difficile à accepter! J’ai appelé l’infirmière pour qu’elle puisse mettre mon lait au réfrigérateur. J’ai dû l’attendre… plusieurs minutes! J’imagine qu’elles pensent à coup sûr que je n’ai pas toute ma tête parce que les patients sur cet étage sont tous malades, aux prises avec une maladie mentale qui les rend « coucous », bizarres. C’est très douloureux pour moi de lire dans les yeux des infirmières leur questionnement à savoir si ce que je dis est vrai (particulièrement les infirmières qui ne sont pas au courant de mon état parce qu’elles n’ont pas lu à ce sujet). Elles semblent comprendre, une fois que je leur explique mon état et/ou qu’elles lisent mon dossier. Mais quand même… Je pense/sens que certaines d’entre elles ne comprennent pas vraiment (quelques-unes sont très compatissantes toutefois. C’est très aidant!). Une infirmière (celle qui était à l’ordinateur) m’a dit d’arrêter de pleurer, que ça ne m’aide pas, a-t-elle dit, à me sentir mieux. Je suis tellement en désaccord! Je lui ai dit qu’en fait, c’est bon d’exprimer mes émotions. J’ai dû lui dire deux fois. Elle n’a pas parue convaincue du tout! Elle a en quelque sorte acquiescé mais cela ne m’aide pas du tout. Je n’ai pas besoin que les gens me disent que tout va s’arranger. J’ai besoin que les gens me regardent et prennent le temps (ou du moins essaient) d’écouter, vraiment écouter ce que j’ai à dire. Je ne veux pas qu’ils me traitent en victime ou comme quelqu’un qui est malade mentale. Je sais que mon mental est affecté mais cela ne veut pas dire que je peux être traitée différemment d’une personne « normale ». Est-ce que je suis une personne « normale » maintenant? Maintenant que j’ai besoin d’un médicament pour me comporter comme une personne « normale »? J’ai tellement peur et je suis tellement préoccupée par le fait de ne plus être ou de ne plus me sentir moi-même à cause de la médication. Je me sens beaucoup mieux que les jours précédents (j’avais écrit en anglais « the precious days » au lieu de « previous days » ). Dieu merci! Je viens juste de voir le mot « precious » que j’ai écrit au lieu de « previous days ». Oui, les jours précieux… pas les jours où j’avais l’air malade mais les jours où je n’étais pas malade. Ces jours étaient/sont précieux… Est-ce que je pourrai me sentir à nouveau comme avant, comme dans les bons jours? J’ai peur de ne plus jamais être moi-même, pour le reste de ma vie. Peut-être vais-je me sentir mieux qu’avant mais je me demande si je vais me sentir confortable avec qui je suis/qui je serai…6h50
Peu de temps après que j’aie écrit ce document, on me servit mon déjeuner. Après avoir mangé, je téléphonai mon mari pour savoir à quelle heure il arriverait à l’hôpital. J’avais vraiment hâte de le voir, de lui raconter comment je me sentais et de lui faire lire ce que j’avais écrit. Il ne tarda pas à arriver avec ma mère et Elliot. Ce dernier avait une fois de plus passer une bonne nuit. Il ne semblait pas affecté par mon absence la nuit. Cela me soulagea beaucoup.
Gerhard pris le temps de lire ce que j’avais écrit plus tôt et il constata que j’avais l’air bien mieux que la veille. Mes propos étaient plus cohérents et mon humeur était plus stable. Toutefois, vers la fin de l’avant-midi, mon humeur se dégrada. Je me mis à passer de la bonne humeur, à l’irritabilité et aux larmes. Mes souvenirs sont plutôt flous, mais je me souviens très bien de mon irritabilité. Ma mère, qui se souciait de mon état, m’encouragea à me reposer et à faire la sieste en même temps qu’Elliot, mais je m’entêtai à refuser de le faire. Je ne me sentais pas fatiguée et les conseils de ma mère, que j’interprétais comme étant de la surprotection, me tapèrent carrément sur les nerfs. Et dès qu’elle voulut m’aider à m’occuper d’Elliot, je le pris personnel. Je pensai qu’elle ne me sentait pas capable de bien prendre soin de mon fils. Cela m’exaspéra et je m’adressai à elle sur un ton plutôt bête. À un certain moment, je me rendis compte de mon hypersensibilité et je m’excusai de ma mauvaise attitude et pour toutes les autres fois où j’allais probablement être irritée par ce qu’elle me dirait. J’étais consciente que je n’étais pas tout à fait moi-même et je ne voulus pas la blesser.
Ce qui me préoccupait davantage au lieu de me reposer, c’était de donner des nouvelles de mon état à mes proches. Gerhard avait apporté mon ordinateur et je tenais absolument à répondre aux courriels de mes amies auxquelles j’avais annoncé la veille que j’étais hospitalisée pour un trouble de l’humeur du post-partum. Le fait de savoir qu’elles pensaient à moi et les messages qu’elles m’envoyèrent me firent du bien. Toutefois, j’avais de la difficulté à mettre un frein aux courriels que j’envoyais et comme je les écrivais en français, Gerhard ne pouvait pas comprendre leur contenu. Cela commença à l’inquiéter un peu, surtout que mon humeur se dégradait avec les heures qui avançaient. À la suite d’un courriel que je reçu et que j’interprétai plutôt mal, Gerhard m’obligea à mettre de côté mon ordinateur. Mon niveau de frustration était inhabituel et exagéré. J’étais pourtant convaincue que ce sentiment était approprié à la situation et que je devais en faire part à la personne concernée. Il me fit alors promettre de ne répondre à aucun courriel sans que je lui en aie lu le contenu avant. Cette contrainte m’agaça sur le coup, mais je lui fis suffisamment confiance pour respecter sa demande.
Vers la fin de l’après-midi, Gerhard s’absenta pour aller reconduire ma mère et Elliot à la maison. Pendant ce temps, je reçus la visite d’un nouveau psychiatre. Dr Sayeed ne travaillait pas cette journée-là et comme mon état nécessitait un suivi quotidien, ce psychiatre vint me voir pour me poser des questions et faire le suivi. Mais quelle désagréable expérience ce fut! Son attitude ne dégagea aucune chaleur tout le temps de l’entretien. Les questions qu’il me posa s’alignèrent à un rythme effréné. Comme j’avais du mal à comprendre son accent et que ma concentration était grandement affectée par mon état, j’avais bien du mal à suivre la cadence. Je l’interrompis à trois reprises pour lui demander de parler moins vite. Il n’en fit aucun cas. Après avoir gribouillé rapidement ses notes au fil de mes réponses, il conclut sa visite en m’annonçant que je souffrais d’un trouble bipolaire et que je serais transférée à l’aile psychiatrique d’ici la fin de la journée. Je ne pourrais pas avoir Elliot avec moi dans ma chambre. En lui mentionnant que je devais l’allaiter, il me répondit que j’aurais à le faire dans une salle spéciale de visite, là où il y aurait moins de risque pour sa sécurité étant donné que les patients de cette section de l’hôpital pouvaient avoir des comportements dangereux. Et voilà! Il me quitta sur cette note des plus encourageantes! Ma tête tournait en essayant d’assimiler toutes ces brusques informations qui me prenaient d’assaut. Mon réflexe fut d’appeler Gerhard sur le champ et de lui expliquer ce qui venait de se passer en mentionnant sur un ton plutôt fébrile le diagnostic que ce psychiatre venait tout juste de me lancer à la figure. Il ne tarda pas à se pointer de nouveau à l’hôpital.
Je fus rassurée de le voir arriver. Mais mes pensées n’étaient orientées que sur le fait que je serais transférée à l’unité psychiatrique sans tarder. Je m’attendais à ce que d’une minute à l’autre, une infirmière se pointe à ma chambre pour me reconduire à une nouvelle chambre. Gerhard était manifestement irrité par le déroulement des événements et il ne cachait pas la frustration qu’il ressentait à l’égard du psychiatre. Comment ce dernier avait-il pu faire preuve de si peu de sensibilité en m’annonçant ce sérieux diagnostic en son absence? C’est ainsi que pour mieux comprendre les motifs du psychiatre et lui manifester son insatisfaction face à la manière dont son entretien avec moi s’était déroulé, il se pointa à la station des infirmières pour demander à le rencontrer. Mais il avait déjà quitté l’unité. Gerhard leur demanda donc si elles étaient au courant de ma relocalisation à l’unité psychiatrique. Une infirmière lui répondit qu’il avait finalement été décidé de me garder dans leur unité en raison de mon bébé. La présence de ce dernier serait une source de complication pour l’unité psychiatrique. Il était plus simple et sécuritaire de nous garder où j’étais. Cette nouvelle nous rassura tous les deux.
Peu de temps après, cette même infirmière se présenta à ma chambre pour demander à Gerhard de la suivre à son poste. Le psychiatre qu’il voulait rencontrer était disponible pour lui parler au téléphone. Gerhard me laissa donc pour s’entretenir avec lui. Il lui fit part de son mécontentement et lui mentionna qu’il aurait apprécié être présent lors de son entretien avec moi et à l’annonce du diagnostic, compte tenu du fait que j’étais visiblement dans un état très instable. Sur un ton ne démontrant pas plus de sensibilité que ce à quoi j’avais eu droit, le psychiatre lui répondit qu’il avait agi selon la façon de faire de cet hôpital. Gerhard n’argumenta pas plus longtemps, réalisant que cela ne mènerait nulle part. Il ne restait plus qu’à espérer ne plus avoir affaire avec lui. Au moins, je n’avais pas à changer de chambre.
En début de soirée, nous reçûmes la visite d’un couple d’amis dont nous avions fait la connaissance au cours de l’année précédente. En les voyant arriver, je fus toute émue par cette marque d’attention de leur part. Je la savais bien occupée avec sa petite famille, surtout qu’elle avait accouché quelques mois avant moi. Elle avait d’ailleurs amené avec elle son jeune bébé qu’elle se mit à allaiter peu de temps après son arrivée. À la vue de ce moment si naturel d’attachement avec son fils, mon cœur se serra. Elliot me manqua alors terriblement. Je désirais moi aussi pouvoir enlacer mon fils à l’instant. Je l’enviais de pouvoir être toujours avec son bébé et d’avoir la santé nécessaire pour s’en occuper elle-même. Ce n’était pas le cas pour moi et j’avais peine à l’accepter.
Mes souvenirs de cette soirée sont décousus. Je me rappelle que nous discutèrent de mon état de santé et d’un autre sujet de conversation orienté sur certains projets futurs de ce couple d’amis. Aucun souvenirs toutefois des sauts d’humeur que je manifestai tout le long de cette visite. D’après les dires de mon mari, je passai des larmes à l’excitation en un rien de temps. Mon humeur était manifestement très instable.
Je me rappelle toutefois très bien les derniers moments de cette visite. Avant de partir, nos amis manifestèrent de l’inquiétude à mon sujet. D’après eux, mon état de santé était le résultat d’une attaque du diable. Satan s’en prenait directement à ma santé pour assombrir les magnifiques moments que Dieu nous avait accordés par la naissance d’Elliot. Pour mieux lutter contre cet assaut, notre ami m’offrit de m’imposer les mains. Je fus d’abord estomaquée par cette conviction de sa part. Étant pourtant moi-même croyante en Dieu, je ne pouvais pas concevoir une association entre la maladie mentale et un quelconque combat spirituel. Je croyais fermement que ma condition était le résultat d’un débalancement hormonal et/ou chimique de mon cerveau. Ne voulant toutefois pas froisser mes amis au niveau de leurs croyances, j’eus le réflexe de refuser gentiment l’imposition des mains en expliquant mon inconfort face à cette pratique. Je suggérai plutôt de prier avec eux, ce qu’ils acceptèrent de faire. Je m’assis donc sur les genoux de mon mari et je dirigeai la prière. Une fois ce temps de recueillement terminé, nos amis nous saluèrent et nous quittèrent ensuite pour retourner chez eux. Gerhard s’assura que je me sentais assez bien pour rester seule puis il me laissa pour retouner à la maison.
Peu de temps après, une infirmière vint me donner ma médication. Une fois dans mon lit, je tombai rapidement dans les bras de Morphée.


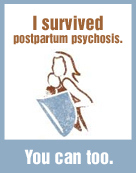
Recent Comments